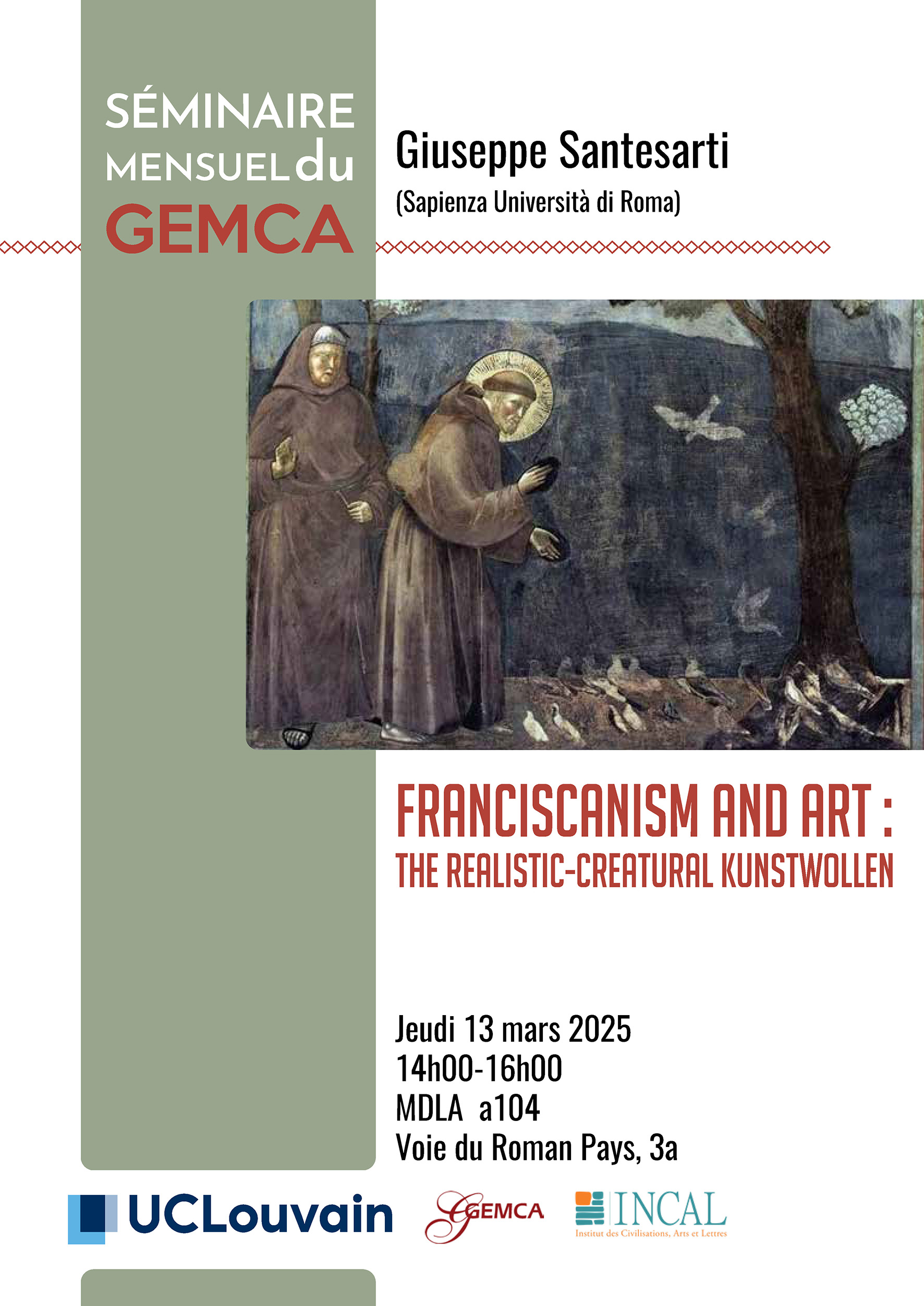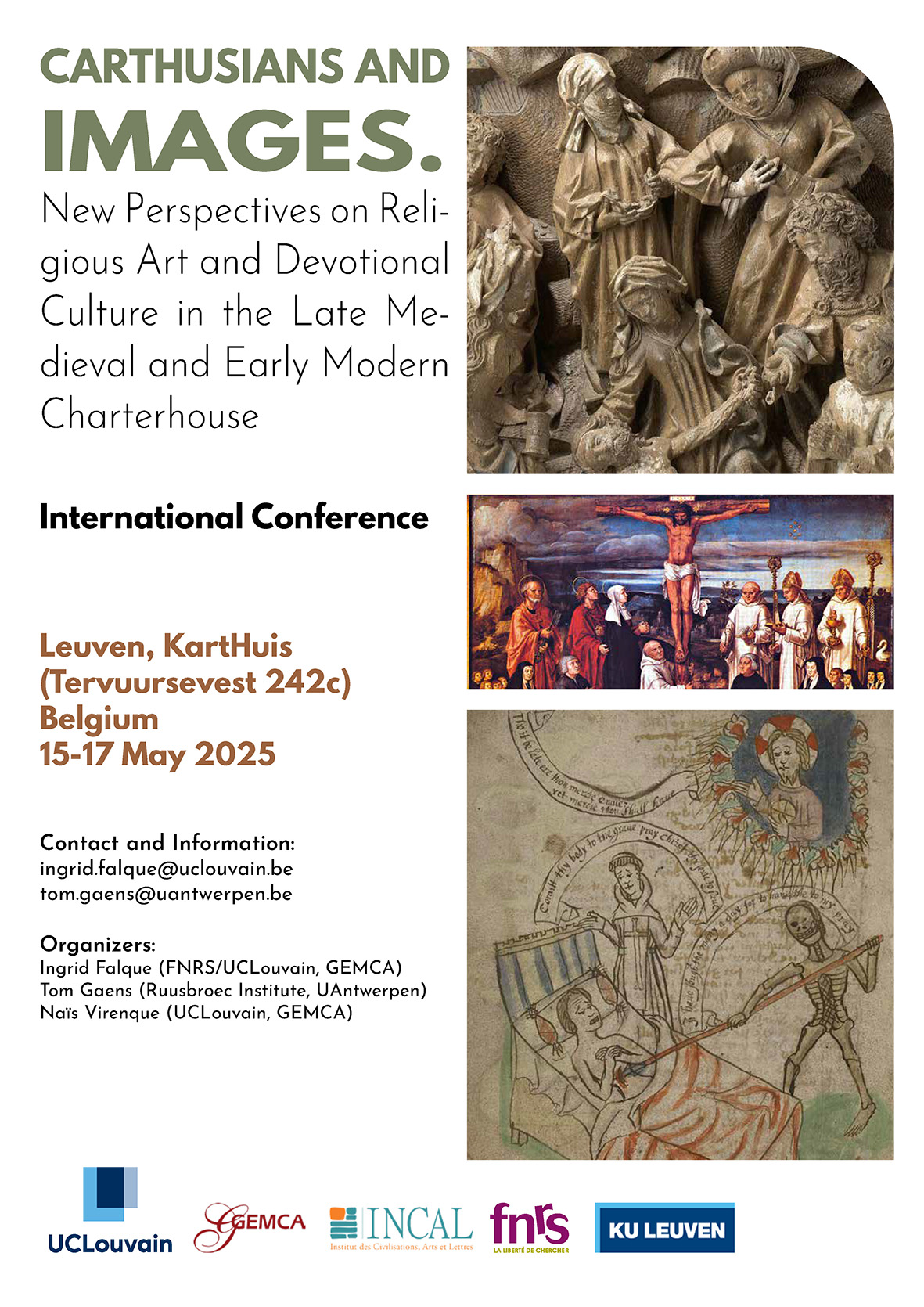2024 - 2025
gemca |
2024 - 2025
-
 Le spectacle des arcanes11 Sep11 Sep...
Le spectacle des arcanes11 Sep11 Sep...Dans un texte désormais célèbre, Denis Richet analysait le travail de la monarchie sur elle-même. Le wébinaire que nous proposons invite à suivre ses analyses, en décentrant le regard sur les acteurs institutionnels, individuels et collectifs, qui, dans l’exercice quotidien de la souveraineté au nom des autorités publiques, travaillent à façonner leurs propres charges, à discuter les ordres qu’ils reçoivent et à feindre l’antiquité de leurs propres pratiques instituées bien souvent récemment, au gré d’un coup politique, d’une disgrâce, d’un changement dynastique. Pour dessiner les contours scientifiques de cet objet de recherche original, les sources mobilisées au cours des séances seront autant des sources iconographiques que textuelles, en questionnant la notion de corpus d’enquête et son lien avec les questionnaires de recherche. La modernité est entendue de manière large, afin de prolonger, pour la première modernité, les analyses heuristiques de la lente montée en puissance des administrations expertes de la fin du Moyen Âge, institutions implantées dans les entourages souverains depuis plus d’un siècle lors du déclenchement des conflits civils et géopolitiques de forte intensité au second XVIe siècle.
La visée des séances est de parvenir à analyser les représentations du pouvoir qui se pense et se donne à voir à lui-même, à la société administrative et à la société politique dans ces discours de formes hybrides, véritables objets politiques dotés d’une efficacité politique et sociale, inscrits au coeur des stratégies de propagande et de communication politique. Cette approche permet également de restituer plus finement quel est le périmètre de la fraction de la société politique que nous proposons de nommer société administrative. Le wébinaire donne la parole à des collègues de disciplines diverses telles que l’histoire, les sciences du droit et les sciences politiques et sociales, la littérature, l’anthropologie, la philosophie et l’histoire des images. Les séances permettent de dresser les entrées d’un questionnaire de recherche en vue de l’organisation d’un colloque international à Bruxelles à l’automne 2025, premier point d’étape de la constitution d’un groupe de recherche transdisciplinaire en histoire et anthropologie culturelles du politique.
 En savoir plus
En savoir plus Le spectacle des arcanes11 Sep11 Sep...
Le spectacle des arcanes11 Sep11 Sep...Dans un texte désormais célèbre, Denis Richet analysait le travail de la monarchie sur elle-même. Le wébinaire que nous proposons invite à suivre ses analyses, en décentrant le regard sur les acteurs institutionnels, individuels et collectifs, qui, dans l’exercice quotidien de la souveraineté au nom des autorités publiques, travaillent à façonner leurs propres charges, à discuter les ordres qu’ils reçoivent et à feindre l’antiquité de leurs propres pratiques instituées bien souvent récemment, au gré d’un coup politique, d’une disgrâce, d’un changement dynastique. Pour dessiner les contours scientifiques de cet objet de recherche original, les sources mobilisées au cours des séances seront autant des sources iconographiques que textuelles, en questionnant la notion de corpus d’enquête et son lien avec les questionnaires de recherche. La modernité est entendue de manière large, afin de prolonger, pour la première modernité, les analyses heuristiques de la lente montée en puissance des administrations expertes de la fin du Moyen Âge, institutions implantées dans les entourages souverains depuis plus d’un siècle lors du déclenchement des conflits civils et géopolitiques de forte intensité au second XVIe siècle.
La visée des séances est de parvenir à analyser les représentations du pouvoir qui se pense et se donne à voir à lui-même, à la société administrative et à la société politique dans ces discours de formes hybrides, véritables objets politiques dotés d’une efficacité politique et sociale, inscrits au coeur des stratégies de propagande et de communication politique. Cette approche permet également de restituer plus finement quel est le périmètre de la fraction de la société politique que nous proposons de nommer société administrative. Le wébinaire donne la parole à des collègues de disciplines diverses telles que l’histoire, les sciences du droit et les sciences politiques et sociales, la littérature, l’anthropologie, la philosophie et l’histoire des images. Les séances permettent de dresser les entrées d’un questionnaire de recherche en vue de l’organisation d’un colloque international à Bruxelles à l’automne 2025, premier point d’étape de la constitution d’un groupe de recherche transdisciplinaire en histoire et anthropologie culturelles du politique.

-
 Le spectacle des arcanes20 Sep20 Sep...
Le spectacle des arcanes20 Sep20 Sep...Dans un texte désormais célèbre, Denis Richet analysait le travail de la monarchie sur elle-même. Le wébinaire que nous proposons invite à suivre ses analyses, en décentrant le regard sur les acteurs institutionnels, individuels et collectifs, qui, dans l’exercice quotidien de la souveraineté au nom des autorités publiques, travaillent à façonner leurs propres charges, à discuter les ordres qu’ils reçoivent et à feindre l’antiquité de leurs propres pratiques instituées bien souvent récemment, au gré d’un coup politique, d’une disgrâce, d’un changement dynastique. Pour dessiner les contours scientifiques de cet objet de recherche original, les sources mobilisées au cours des séances seront autant des sources iconographiques que textuelles, en questionnant la notion de corpus d’enquête et son lien avec les questionnaires de recherche. La modernité est entendue de manière large, afin de prolonger, pour la première modernité, les analyses heuristiques de la lente montée en puissance des administrations expertes de la fin du Moyen Âge, institutions implantées dans les entourages souverains depuis plus d’un siècle lors du déclenchement des conflits civils et géopolitiques de forte intensité au second XVIe siècle.
La visée des séances est de parvenir à analyser les représentations du pouvoir qui se pense et se donne à voir à lui-même, à la société administrative et à la société politique dans ces discours de formes hybrides, véritables objets politiques dotés d’une efficacité politique et sociale, inscrits au coeur des stratégies de propagande et de communication politique. Cette approche permet également de restituer plus finement quel est le périmètre de la fraction de la société politique que nous proposons de nommer société administrative. Le wébinaire donne la parole à des collègues de disciplines diverses telles que l’histoire, les sciences du droit et les sciences politiques et sociales, la littérature, l’anthropologie, la philosophie et l’histoire des images. Les séances permettent de dresser les entrées d’un questionnaire de recherche en vue de l’organisation d’un colloque international à Bruxelles à l’automne 2025, premier point d’étape de la constitution d’un groupe de recherche transdisciplinaire en histoire et anthropologie culturelles du politique.
 En savoir plus
En savoir plus Le spectacle des arcanes20 Sep20 Sep...
Le spectacle des arcanes20 Sep20 Sep...Dans un texte désormais célèbre, Denis Richet analysait le travail de la monarchie sur elle-même. Le wébinaire que nous proposons invite à suivre ses analyses, en décentrant le regard sur les acteurs institutionnels, individuels et collectifs, qui, dans l’exercice quotidien de la souveraineté au nom des autorités publiques, travaillent à façonner leurs propres charges, à discuter les ordres qu’ils reçoivent et à feindre l’antiquité de leurs propres pratiques instituées bien souvent récemment, au gré d’un coup politique, d’une disgrâce, d’un changement dynastique. Pour dessiner les contours scientifiques de cet objet de recherche original, les sources mobilisées au cours des séances seront autant des sources iconographiques que textuelles, en questionnant la notion de corpus d’enquête et son lien avec les questionnaires de recherche. La modernité est entendue de manière large, afin de prolonger, pour la première modernité, les analyses heuristiques de la lente montée en puissance des administrations expertes de la fin du Moyen Âge, institutions implantées dans les entourages souverains depuis plus d’un siècle lors du déclenchement des conflits civils et géopolitiques de forte intensité au second XVIe siècle.
La visée des séances est de parvenir à analyser les représentations du pouvoir qui se pense et se donne à voir à lui-même, à la société administrative et à la société politique dans ces discours de formes hybrides, véritables objets politiques dotés d’une efficacité politique et sociale, inscrits au coeur des stratégies de propagande et de communication politique. Cette approche permet également de restituer plus finement quel est le périmètre de la fraction de la société politique que nous proposons de nommer société administrative. Le wébinaire donne la parole à des collègues de disciplines diverses telles que l’histoire, les sciences du droit et les sciences politiques et sociales, la littérature, l’anthropologie, la philosophie et l’histoire des images. Les séances permettent de dresser les entrées d’un questionnaire de recherche en vue de l’organisation d’un colloque international à Bruxelles à l’automne 2025, premier point d’étape de la constitution d’un groupe de recherche transdisciplinaire en histoire et anthropologie culturelles du politique.

-
 La parole représentée / représenter la parole. De l’acte de langage à l’acte04 Oct04 Oct...
La parole représentée / représenter la parole. De l’acte de langage à l’acte04 Oct04 Oct...Programme

Programme :
Introduction
9h45-10h, Jérémie Ferrer-Bartomeu : Parole rare, parole profuse. Les enjeux de l'anthropologie politique et religieuse de la parole
10h-10h15, Ralph Dekoninck : Faire parler les images. L'anthropologie de la parole au prisme des études visuelles
Première session
10h15-11h15, Marta Battisti : L'église de Sainct Vital, entre image et paroles
11h15-12h15, Adrien Aracil : Une représentation contrariée : de la difficulté de « porter la parole » des assemblées politiques réformées
Lunch
Deuxième session
13h15-14h15, Julien Régibeau : Représenter la parole représentée. La diplomatie pontificale et la rencontre entre Attila et Léon Ier au milieu du XVIIe siècle
14h15-15h15, Aurélien Destain : Représenter la paix proclamée ». La prestation de serment de la ratification de la paix de Munster du 15 mai 1648, d’après Ter Borch
Pause
Troisième session
15h30-16h30 Judith Roche : Le motif de la « marmite » dans la polémique interconfessionnelle de la seconde moitié du XVIe siècle
16h30-17h30, Monique Weis : Philippe de Marnix à l'assemblée impériale de Worms (1578). Paroles et gestes d'une ambassade
En savoir plus La parole représentée / représenter la parole. De l’acte de langage à l’acte04 Oct04 Oct...
La parole représentée / représenter la parole. De l’acte de langage à l’acte04 Oct04 Oct...Programme

Programme :
Introduction
9h45-10h, Jérémie Ferrer-Bartomeu : Parole rare, parole profuse. Les enjeux de l'anthropologie politique et religieuse de la parole
10h-10h15, Ralph Dekoninck : Faire parler les images. L'anthropologie de la parole au prisme des études visuelles
Première session
10h15-11h15, Marta Battisti : L'église de Sainct Vital, entre image et paroles
11h15-12h15, Adrien Aracil : Une représentation contrariée : de la difficulté de « porter la parole » des assemblées politiques réformées
Lunch
Deuxième session
13h15-14h15, Julien Régibeau : Représenter la parole représentée. La diplomatie pontificale et la rencontre entre Attila et Léon Ier au milieu du XVIIe siècle
14h15-15h15, Aurélien Destain : Représenter la paix proclamée ». La prestation de serment de la ratification de la paix de Munster du 15 mai 1648, d’après Ter Borch
Pause
Troisième session
15h30-16h30 Judith Roche : Le motif de la « marmite » dans la polémique interconfessionnelle de la seconde moitié du XVIe siècle
16h30-17h30, Monique Weis : Philippe de Marnix à l'assemblée impériale de Worms (1578). Paroles et gestes d'une ambassade
-
 Le troisième corps du roi. Représentations, savoirs administratifs et matérialités politiques dans l'Europe de la première modernité24 Oct24 Oct...
Le troisième corps du roi. Représentations, savoirs administratifs et matérialités politiques dans l'Europe de la première modernité24 Oct24 Oct...Séminaire avec Jérémie Ferre-Bartomeu
Répondant : Maxime CartronLe séminaire est consacré à la méthode et aux premiers résultats du projet de recherche de J. Ferrer-Bartomeu. Ce projet consiste à comprendre pourquoi le pouvoir se rend visible, sous quelles conditions de possibilité historique et théorique, par quels moyens, pour quels profits et en courant quels risques, notamment en période de guerres civiles. Les questions liées à la visibilité des phénomènes et processus politiques, comme celles portant sur la figurabilité du pouvoir, entrent en dialogue avec l’analyse de la performance des textes et des images dans la société politique. Il souhaite ainsi étudier ce que le pouvoir fait des discours et, par effet retour, ce que les discours font au pouvoir. Le projet entend montrer comment l’expression visuelle et textuelle des administrateurs et magistrats de l’État structurent les arcanes du pouvoir, agencent des dispositifs de décision, de domination, de conseil, d’arbitrage et de négociation, mais aussi modifient les imaginaires des individus-collectifs que sont les institutions. L'hypothèse principale de travail consiste à montrer que la société administrative, pointe avancée de la société politique, forme un groupe professionnel relativement cohérent à l'échelle continentale qui trouve les ferments de son unité dans sa représentation, son instrumentation de savoirs experts et la matérialité spécifique des objets du politique qu'il manie. Cette société administrative forme ainsi, selon J. Ferrer-Bartomeu, un troisième corps du roi, distinct du corps mortel du souverain et de son corps mystique, tabernacle fragile de la Majesté.
 En savoir plus
En savoir plus Le troisième corps du roi. Représentations, savoirs administratifs et matérialités politiques dans l'Europe de la première modernité24 Oct24 Oct...
Le troisième corps du roi. Représentations, savoirs administratifs et matérialités politiques dans l'Europe de la première modernité24 Oct24 Oct...Séminaire avec Jérémie Ferre-Bartomeu
Répondant : Maxime CartronLe séminaire est consacré à la méthode et aux premiers résultats du projet de recherche de J. Ferrer-Bartomeu. Ce projet consiste à comprendre pourquoi le pouvoir se rend visible, sous quelles conditions de possibilité historique et théorique, par quels moyens, pour quels profits et en courant quels risques, notamment en période de guerres civiles. Les questions liées à la visibilité des phénomènes et processus politiques, comme celles portant sur la figurabilité du pouvoir, entrent en dialogue avec l’analyse de la performance des textes et des images dans la société politique. Il souhaite ainsi étudier ce que le pouvoir fait des discours et, par effet retour, ce que les discours font au pouvoir. Le projet entend montrer comment l’expression visuelle et textuelle des administrateurs et magistrats de l’État structurent les arcanes du pouvoir, agencent des dispositifs de décision, de domination, de conseil, d’arbitrage et de négociation, mais aussi modifient les imaginaires des individus-collectifs que sont les institutions. L'hypothèse principale de travail consiste à montrer que la société administrative, pointe avancée de la société politique, forme un groupe professionnel relativement cohérent à l'échelle continentale qui trouve les ferments de son unité dans sa représentation, son instrumentation de savoirs experts et la matérialité spécifique des objets du politique qu'il manie. Cette société administrative forme ainsi, selon J. Ferrer-Bartomeu, un troisième corps du roi, distinct du corps mortel du souverain et de son corps mystique, tabernacle fragile de la Majesté.

-
 Écriture diplomatique et burocratisation25 Oct25 Oct...
Écriture diplomatique et burocratisation25 Oct25 Oct...Le développement de la résidentialité des ambassadeurs à la charnière des périodes médiévale et moderne entraîne l'essor de la dépêche diplomatique, nouveau type d'écrit politique aux fonctions complexes. La démultiplication des postes à l'étranger, leur indispensable coordination et l'abondance et la régularité des correspondances ainsi établies favorisent en retour une bureaucratisation progressive de la gestion de l'appareil diplomatique de l'État, mise en évidence par les travaux de M. Haehl pour le premier XVIIe siècle ou John C. Rule et Ben S. Trotter pour le ministériat de Torcy (1696-1715). Dans ce contexte, la dépêche diplomatique n'échappe à un processus de normalisation, dans sa forme, comme dans son style et son contenu, qui fait l'objet des réflexions qui seront présentées. Portée par une consolidation des pratiques d'écriture, cette normalisation semble dès la fin du XVIe siècle une nécessité pour les auteurs de traités sur l'ambassadeur, qui en dessinent les contours généraux. Elle passe aussi par la diffusion de modèles d'écriture à travers la publication de grandes correspondances diplomatiques dans le premier XVIIe siècle. Elle est enfin systématisée par les bureaux du secrétariat d'État des Affaires étrangères à travers une véritable pédagogie de l'écriture diplomatique qui se met en place au XVIIIe siècle à destination des ambassadeurs inexpérimentés.
 En savoir plus
En savoir plus Écriture diplomatique et burocratisation25 Oct25 Oct...
Écriture diplomatique et burocratisation25 Oct25 Oct...Le développement de la résidentialité des ambassadeurs à la charnière des périodes médiévale et moderne entraîne l'essor de la dépêche diplomatique, nouveau type d'écrit politique aux fonctions complexes. La démultiplication des postes à l'étranger, leur indispensable coordination et l'abondance et la régularité des correspondances ainsi établies favorisent en retour une bureaucratisation progressive de la gestion de l'appareil diplomatique de l'État, mise en évidence par les travaux de M. Haehl pour le premier XVIIe siècle ou John C. Rule et Ben S. Trotter pour le ministériat de Torcy (1696-1715). Dans ce contexte, la dépêche diplomatique n'échappe à un processus de normalisation, dans sa forme, comme dans son style et son contenu, qui fait l'objet des réflexions qui seront présentées. Portée par une consolidation des pratiques d'écriture, cette normalisation semble dès la fin du XVIe siècle une nécessité pour les auteurs de traités sur l'ambassadeur, qui en dessinent les contours généraux. Elle passe aussi par la diffusion de modèles d'écriture à travers la publication de grandes correspondances diplomatiques dans le premier XVIIe siècle. Elle est enfin systématisée par les bureaux du secrétariat d'État des Affaires étrangères à travers une véritable pédagogie de l'écriture diplomatique qui se met en place au XVIIIe siècle à destination des ambassadeurs inexpérimentés.

-
 Entre art et dévotion : les formes et les fonctions de l'encadrement fictif dans les images de la dévotion privée du Quattrocento (Italie centrale et Italie septentrionale)20 Nov20 Nov...
Entre art et dévotion : les formes et les fonctions de l'encadrement fictif dans les images de la dévotion privée du Quattrocento (Italie centrale et Italie septentrionale)20 Nov20 Nov...
Séminaire mensuel avec Elizaveta Falkova, Entre art et dévotion : les formes et les fonctions de l'encadrement fictif dans les images de la dévotion privée du Quattrocento (Italie centrale et Italie septentrionale)
Répondant : Giacomo Fuk
Ce projet vise à analyser le rôle qu’a pu jouer le cadre fictif (c’est-à-dire intégré en tant que motif dans la peinture même) au niveau de l’articulation des enjeux dévotionnels et artistiques au XVe siècle en Italie. Le corpus étudié se compose d’images dont les sujets religieux sont assez communs (notamment la Vierge à l’Enfant, mais aussi l’Homme de douleurs, les saints et saintes à mi-corps) et qui sont destinées à un usage privé. Le cadre fictif est entendu au sens large en tant que motif architectural qui délimite le personnage et le circonscrit dans un lieu ; dans certaines images ce cadrage s’étend aussi au paysage. La fréquence de l’encadrement fictif et la riche variété des formes qu’il a pu prendre témoignent de son importance dans la conception et la réception de ce type d’images au XVe siècle en Italie.
L’objectif est d’étudier la polysémie du cadre fictif (symbole religieux, signe iconique, dispositif métapictural) qui se révèle dans les rapports qu’il entretient avec les autres composantes de l’image (y compris le cadre réel) aussi bien qu’à travers son rôle dans l’expérience dévotionnelle et visuelle du spectateur. En soulignant son agentivité qui se manifeste notamment dans l’instauration de ces rapports, ce travail vise à prendre en considération les statuts, les fonctions et les usages de l’encadrement fictif, qui reste souvent délaissé dans les analyses comme une convention décorative. En d’autres termes, j’analyse dans quelle mesure l’acte de redoubler l’opération du cadrage matériel au sein de l’image est indissociable des fonctions dévotionnelle et artistique de celle-ci. Peindre le cadre au sein des images de la Vierge et du Christ permettrait aux artistes de penser les propriétés du cadre pour figurer l’Incarnation et/ou affirmer la spécificité de la peinture comme art, telle est mon hypothèse. Quant aux images des saints et saintes, le partage des encadrements fictifs avec les portraits laïcs de l’époques révèle la porosité entre les iconographies sacrée et profane. En étudiant de la sorte la genèse et le développement des cadres à partir d’études de cas, je souligne la forte présence de l’intervisualité entre les genres (image dévotionnelle et portrait laïc), entre les médiums (peinture, sculpture, architecture), et enfin entre les cultures italienne et flamande.
En savoir plus Entre art et dévotion : les formes et les fonctions de l'encadrement fictif dans les images de la dévotion privée du Quattrocento (Italie centrale et Italie septentrionale)20 Nov20 Nov...
Entre art et dévotion : les formes et les fonctions de l'encadrement fictif dans les images de la dévotion privée du Quattrocento (Italie centrale et Italie septentrionale)20 Nov20 Nov...
Séminaire mensuel avec Elizaveta Falkova, Entre art et dévotion : les formes et les fonctions de l'encadrement fictif dans les images de la dévotion privée du Quattrocento (Italie centrale et Italie septentrionale)
Répondant : Giacomo Fuk
Ce projet vise à analyser le rôle qu’a pu jouer le cadre fictif (c’est-à-dire intégré en tant que motif dans la peinture même) au niveau de l’articulation des enjeux dévotionnels et artistiques au XVe siècle en Italie. Le corpus étudié se compose d’images dont les sujets religieux sont assez communs (notamment la Vierge à l’Enfant, mais aussi l’Homme de douleurs, les saints et saintes à mi-corps) et qui sont destinées à un usage privé. Le cadre fictif est entendu au sens large en tant que motif architectural qui délimite le personnage et le circonscrit dans un lieu ; dans certaines images ce cadrage s’étend aussi au paysage. La fréquence de l’encadrement fictif et la riche variété des formes qu’il a pu prendre témoignent de son importance dans la conception et la réception de ce type d’images au XVe siècle en Italie.
L’objectif est d’étudier la polysémie du cadre fictif (symbole religieux, signe iconique, dispositif métapictural) qui se révèle dans les rapports qu’il entretient avec les autres composantes de l’image (y compris le cadre réel) aussi bien qu’à travers son rôle dans l’expérience dévotionnelle et visuelle du spectateur. En soulignant son agentivité qui se manifeste notamment dans l’instauration de ces rapports, ce travail vise à prendre en considération les statuts, les fonctions et les usages de l’encadrement fictif, qui reste souvent délaissé dans les analyses comme une convention décorative. En d’autres termes, j’analyse dans quelle mesure l’acte de redoubler l’opération du cadrage matériel au sein de l’image est indissociable des fonctions dévotionnelle et artistique de celle-ci. Peindre le cadre au sein des images de la Vierge et du Christ permettrait aux artistes de penser les propriétés du cadre pour figurer l’Incarnation et/ou affirmer la spécificité de la peinture comme art, telle est mon hypothèse. Quant aux images des saints et saintes, le partage des encadrements fictifs avec les portraits laïcs de l’époques révèle la porosité entre les iconographies sacrée et profane. En étudiant de la sorte la genèse et le développement des cadres à partir d’études de cas, je souligne la forte présence de l’intervisualité entre les genres (image dévotionnelle et portrait laïc), entre les médiums (peinture, sculpture, architecture), et enfin entre les cultures italienne et flamande.
-
 Les réceptions de la spiritualité médiévale des Pays-Bas et de la région rhénane en Europe à l’époque moderne. Héritages, circulations et réseaux27 Nov29 Nov...
Les réceptions de la spiritualité médiévale des Pays-Bas et de la région rhénane en Europe à l’époque moderne. Héritages, circulations et réseaux27 Nov29 Nov...Voir le programme

Ce colloque interdisciplinaire se propose d’aborder les réceptions en Europe à l’époque moderne des courants spirituels médiévaux des Pays-Bas et de la région rhénane sous toutes leurs formes (théologie, mystique, pastorale, ascétique). Dans le contexte de la Réforme, la chartreuse de Cologne est, sous l’influence de Pierre Blomevenna, Jean Lansperge et Laurent Surius, le lieu d’une entreprise importante de traduction et de publication de textes mystiques et ascétiques, comme ceux de Jan van Ruusbroec, Henri Suso, Johannes Tauler, Denys le Chartreux, ou de la Perle évangélique (Chaix 1981, Hoenen 2008, Fournier 2018, Wehrli-Johns 2018). D’autre part, l’influence, plus souterraine, d’auteurs de la Devotio Moderna tels que Geert Grote, Florens Radewijns, Gerard Zerbolt van Zutphen, Thomas a Kempis, Wessel Gansfort ou Jan Mombaer, sur les spiritualités modernes, dont celles d’Érasme et d’Ignace de Loyola, est bien connue (Watrigant 1897, Bataillon 1937, O’Reilly 2021). Divers courants de l’époque moderne portent ces héritages et suggèrent leurs interactions réciproques, comme en témoignent, en France au XVIIe siècle, le cercle de Richard Beaucousin autour duquel gravitent François de Sales, Barbe Acarie et Pierre de Bérulle (Bremond 1916-1936, Orcibal 1959, Cognet 1968), ainsi que les recueils de Maximilian Van der Sandt et de Pierre Poiret, qui connurent une diffusion à l’échelle européenne (Dekoninck-Guiderdoni 2019), pour ne citer que quelques exemples.
En distinguant « réception explicite » et « réception implicite » (Falque-Guiderdoni 2022), ce colloque envisage les processus historiques de cette transmission. Les travaux existants abordent des auteurs en particulier (Duval 1966, Gueullette 2012, Schepers et al. 2021, Schepers 2022), mais une perspective plus large sur cette question fait défaut à ce jour. Il s’agit aussi de dépasser la rupture entre les périodes médiévale et moderne (Ferrer et al. 2019-2021), encore souvent de mise dans les études d’histoire intellectuelle et culturelle, tout en soulignant les transformations spécifiques à la période considérée et qui affectent la circulation des doctrines, des textes, des images et des pratiques, au sein de et entre pays et ordres religieux.
En savoir plus Les réceptions de la spiritualité médiévale des Pays-Bas et de la région rhénane en Europe à l’époque moderne. Héritages, circulations et réseaux27 Nov29 Nov...
Les réceptions de la spiritualité médiévale des Pays-Bas et de la région rhénane en Europe à l’époque moderne. Héritages, circulations et réseaux27 Nov29 Nov...Voir le programme

Ce colloque interdisciplinaire se propose d’aborder les réceptions en Europe à l’époque moderne des courants spirituels médiévaux des Pays-Bas et de la région rhénane sous toutes leurs formes (théologie, mystique, pastorale, ascétique). Dans le contexte de la Réforme, la chartreuse de Cologne est, sous l’influence de Pierre Blomevenna, Jean Lansperge et Laurent Surius, le lieu d’une entreprise importante de traduction et de publication de textes mystiques et ascétiques, comme ceux de Jan van Ruusbroec, Henri Suso, Johannes Tauler, Denys le Chartreux, ou de la Perle évangélique (Chaix 1981, Hoenen 2008, Fournier 2018, Wehrli-Johns 2018). D’autre part, l’influence, plus souterraine, d’auteurs de la Devotio Moderna tels que Geert Grote, Florens Radewijns, Gerard Zerbolt van Zutphen, Thomas a Kempis, Wessel Gansfort ou Jan Mombaer, sur les spiritualités modernes, dont celles d’Érasme et d’Ignace de Loyola, est bien connue (Watrigant 1897, Bataillon 1937, O’Reilly 2021). Divers courants de l’époque moderne portent ces héritages et suggèrent leurs interactions réciproques, comme en témoignent, en France au XVIIe siècle, le cercle de Richard Beaucousin autour duquel gravitent François de Sales, Barbe Acarie et Pierre de Bérulle (Bremond 1916-1936, Orcibal 1959, Cognet 1968), ainsi que les recueils de Maximilian Van der Sandt et de Pierre Poiret, qui connurent une diffusion à l’échelle européenne (Dekoninck-Guiderdoni 2019), pour ne citer que quelques exemples.
En distinguant « réception explicite » et « réception implicite » (Falque-Guiderdoni 2022), ce colloque envisage les processus historiques de cette transmission. Les travaux existants abordent des auteurs en particulier (Duval 1966, Gueullette 2012, Schepers et al. 2021, Schepers 2022), mais une perspective plus large sur cette question fait défaut à ce jour. Il s’agit aussi de dépasser la rupture entre les périodes médiévale et moderne (Ferrer et al. 2019-2021), encore souvent de mise dans les études d’histoire intellectuelle et culturelle, tout en soulignant les transformations spécifiques à la période considérée et qui affectent la circulation des doctrines, des textes, des images et des pratiques, au sein de et entre pays et ordres religieux.
-
 L’ornementation sur les textiles liturgiques du XVIe au XVIIIe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux19 Dec19 Dec...
L’ornementation sur les textiles liturgiques du XVIe au XVIIIe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux19 Dec19 Dec...Séminaire avec Mireille Gilbert, L’ornementation sur les textiles liturgiques du XVIe au XVIIIe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux : étude matérielle. Enjeux liturgiques, confessionnels et identitaires
Répondante : Naïs Virenque
Après un constat basé sur l’observation matérielle des textiles liturgiques encore conservés dans les musées et sacristies et la présentation succincte de leurs caractéristiques communes, l’attention sera portée sur l’ornementation des textiles et l’évolution de celle-ci entre 1550 et 1800 ca. Quelles influences subit cette ornementation ? En quoi soutient-elle la cérémonie pour laquelle le vêtement a été conçu ?
Objets de prestige, affichant la richesse et le pouvoir des commanditaires, les textiles liturgiques, par leur ornementation qui ne laisse rien au hasard, sont des pièces essentielles au déroulement des cérémonies qu’ils rehaussent de leur lustre et de leur éclat. Leur ornement proclame aussi un soutien ferme à la Contre-Réforme et à l’Église.
 En savoir plus
En savoir plus L’ornementation sur les textiles liturgiques du XVIe au XVIIIe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux19 Dec19 Dec...
L’ornementation sur les textiles liturgiques du XVIe au XVIIIe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux19 Dec19 Dec...Séminaire avec Mireille Gilbert, L’ornementation sur les textiles liturgiques du XVIe au XVIIIe siècle dans les anciens Pays-Bas méridionaux : étude matérielle. Enjeux liturgiques, confessionnels et identitaires
Répondante : Naïs Virenque
Après un constat basé sur l’observation matérielle des textiles liturgiques encore conservés dans les musées et sacristies et la présentation succincte de leurs caractéristiques communes, l’attention sera portée sur l’ornementation des textiles et l’évolution de celle-ci entre 1550 et 1800 ca. Quelles influences subit cette ornementation ? En quoi soutient-elle la cérémonie pour laquelle le vêtement a été conçu ?
Objets de prestige, affichant la richesse et le pouvoir des commanditaires, les textiles liturgiques, par leur ornementation qui ne laisse rien au hasard, sont des pièces essentielles au déroulement des cérémonies qu’ils rehaussent de leur lustre et de leur éclat. Leur ornement proclame aussi un soutien ferme à la Contre-Réforme et à l’Église.

-
 De l’Europe du Nord à la péninsule ibérique31 Jan31 Jan...
De l’Europe du Nord à la péninsule ibérique31 Jan31 Jan...Organisateurs : Jean-Marie Guillouët (Université de Bourgogne/Institut universitaire de France) et Pedro Redol Lourenço da Silva (Musée/Couvent de Santa Maria da Vitória de Batalha).
La sculpture portugaise de la fin du Moyen Âge et de la première modernité offre un terrain d’observation particulièrement favorable pour comprendre les mécaniques comme les chronologies des transferts culturels qui forgèrent le panorama artistique européen. Dans une perspective transnationale et non mediterrannéo-centrée, nous ambitionnons de réécrire les récits de l'histoire de l'art en prenant acte pour la première fois du rôle central et structurant des nombreux acteurs septentrionaux (hennuyers, picards, flamands, brabançons, normands...) au Portugal comme à Madère. Il s'agit pour cette journée d'étude de repenser à nouveaux frais les récits de la discipline en engageant d'abord un dialogue historiographique prolongeant les premières réflexions engagées il y a plusieurs décennies par Marcel Aubert en France ou Ignace Vandevivere en Belgique.
 En savoir plus
En savoir plus De l’Europe du Nord à la péninsule ibérique31 Jan31 Jan...
De l’Europe du Nord à la péninsule ibérique31 Jan31 Jan...Organisateurs : Jean-Marie Guillouët (Université de Bourgogne/Institut universitaire de France) et Pedro Redol Lourenço da Silva (Musée/Couvent de Santa Maria da Vitória de Batalha).
La sculpture portugaise de la fin du Moyen Âge et de la première modernité offre un terrain d’observation particulièrement favorable pour comprendre les mécaniques comme les chronologies des transferts culturels qui forgèrent le panorama artistique européen. Dans une perspective transnationale et non mediterrannéo-centrée, nous ambitionnons de réécrire les récits de l'histoire de l'art en prenant acte pour la première fois du rôle central et structurant des nombreux acteurs septentrionaux (hennuyers, picards, flamands, brabançons, normands...) au Portugal comme à Madère. Il s'agit pour cette journée d'étude de repenser à nouveaux frais les récits de la discipline en engageant d'abord un dialogue historiographique prolongeant les premières réflexions engagées il y a plusieurs décennies par Marcel Aubert en France ou Ignace Vandevivere en Belgique.

-
 Séjour de Vincent Debiais (CNRS, EHESS)09 Apr09 Apr10 Apr10 Apr...
Séjour de Vincent Debiais (CNRS, EHESS)09 Apr09 Apr10 Apr10 Apr...Séjour « chercheur invité INCAL » de Vincent Debiais (CNRS, EHESS)
9 avril, 16h (salle à confirmer) « La couleur seule : monochromie et abstraction dans l’art du Moyen Âge occidental »1
10 avril, 14h-16h : séminaire du GEMCA « La Transfiguration du recueil de Cluny : poésie liturgique et création d’image »
En savoir plus Séjour de Vincent Debiais (CNRS, EHESS)09 Apr09 Apr10 Apr10 Apr...
Séjour de Vincent Debiais (CNRS, EHESS)09 Apr09 Apr10 Apr10 Apr...Séjour « chercheur invité INCAL » de Vincent Debiais (CNRS, EHESS)
9 avril, 16h (salle à confirmer) « La couleur seule : monochromie et abstraction dans l’art du Moyen Âge occidental »1
10 avril, 14h-16h : séminaire du GEMCA « La Transfiguration du recueil de Cluny : poésie liturgique et création d’image »
-
 L’humanisme juridique est-il encore une affaire de juristes ?11 Apr11 Apr...
L’humanisme juridique est-il encore une affaire de juristes ?11 Apr11 Apr...À partir d’une sélection de publications, Anne Rousselet-Pimont et Xavier Prévost dialogueront sur la place des juristes dans l’historiographie de l’humanisme juridique. Ils se demanderont quelles peuvent être les contributions spécifiques des spécialistes du droit à la compréhension de ce mouvement intellectuel fondé sur une approche encyclopédique du savoir. Pour cela, ils reviendront notamment sur la dimension politique de l’humanisme juridique, en particulier le rôle joué par ses membres dans la construction de l’État moderne.
Cet événement est organisé par le groupe de contact F.R.S.-FNRS Histoire et anthropologie de l'État (présidence : Manuel Cervera-Marzal (FNRS/ULiège), secrétariat : Jérémie Ferrer-Bartomeu (FNRS/UCLouvain)
Professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Anne Rousselet-Pimont enseigne l’histoire du droit et dirige le M2 Histoire de la pensée juridique moderne. Elle est membre de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS). Ses travaux portent sur l’histoire des sources du droit, l’histoire de la justice et l’histoire de la comparaison des droits et interrogent plus particulièrement la méthode et le discours des anciens juristes. Spécialisée dans l’histoire de la première modernité, elle appartient au Réseau Humanisme juridique, à la Société d’histoire du droit (SHD) et à l’Association des historiens des facultés de droit (AHFD).
Le Chancelier et la loi au XVIe siècle, d’après l’œuvre d’Antoine Duprat, Guillaume Poyet et Michel de L’Hospital, Paris, De Boccard, 2005.
« L’unité du droit vue par un arrêtiste toulousain, Géraud de Maynard (1537-1607) », La règle de l’unité ? Le juge et le droit du roi dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle) sous la direction de P. Arabeyre et d’O. Poncet, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 19-44.
« Cujas et les arrêtistes. L’écho de l’École au Palais », communication au colloque Jacques Cujas 1522-1590. La Fabrique d’un “grand juriste”, Paris, Editions du Collège de France, Collection « Conférences », p. 177-196.
Xavier Prévost est agrégé des facultés de droit, agrégé d'économie et gestion, archiviste paléographe (diplômé de l'École des chartes) et ancien élève de l'ENS Cachan. Membre junior de l'Institut universitaire de France (promotion 2020), il est professeur d'histoire du droit à l'université de Bordeaux et porteur du projet ISTHisFrench (ERC-2024-COG 101170233). Il coordonne avec Luigi-Alberto Sanchi le Réseau Humanisme juridique. Ses recherches concernent le droit et les savoirs juridiques à la Renaissance et interrogent, en particulier, l'émergence de la modernité juridique.
Jacques Cujas (1522-1590), Jurisconsulte humaniste, Genève, Droz (Travaux d’Humanisme et Renaissance), 2015 ; rééd. Genève, Droz (Titre courant), 2025
Jacques Cujas, la fabrique d’un « grand juriste », dir. Alexandra Gottely, Dario Mantovani et Xavier Prévost, Paris, Éditions du Collège de France, 2024
L’Humanisme juridique. Aspects d’un phénomène intellectuel européen, dir. Xavier Prévost et Luigi-Alberto Sanchi, Paris, Classiques Garnier (Esprit des lois, Esprit des lettres), 2022 [https://doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-11801-5]
 En savoir plus
En savoir plus L’humanisme juridique est-il encore une affaire de juristes ?11 Apr11 Apr...
L’humanisme juridique est-il encore une affaire de juristes ?11 Apr11 Apr...À partir d’une sélection de publications, Anne Rousselet-Pimont et Xavier Prévost dialogueront sur la place des juristes dans l’historiographie de l’humanisme juridique. Ils se demanderont quelles peuvent être les contributions spécifiques des spécialistes du droit à la compréhension de ce mouvement intellectuel fondé sur une approche encyclopédique du savoir. Pour cela, ils reviendront notamment sur la dimension politique de l’humanisme juridique, en particulier le rôle joué par ses membres dans la construction de l’État moderne.
Cet événement est organisé par le groupe de contact F.R.S.-FNRS Histoire et anthropologie de l'État (présidence : Manuel Cervera-Marzal (FNRS/ULiège), secrétariat : Jérémie Ferrer-Bartomeu (FNRS/UCLouvain)
Professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Anne Rousselet-Pimont enseigne l’histoire du droit et dirige le M2 Histoire de la pensée juridique moderne. Elle est membre de l’Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS). Ses travaux portent sur l’histoire des sources du droit, l’histoire de la justice et l’histoire de la comparaison des droits et interrogent plus particulièrement la méthode et le discours des anciens juristes. Spécialisée dans l’histoire de la première modernité, elle appartient au Réseau Humanisme juridique, à la Société d’histoire du droit (SHD) et à l’Association des historiens des facultés de droit (AHFD).
Le Chancelier et la loi au XVIe siècle, d’après l’œuvre d’Antoine Duprat, Guillaume Poyet et Michel de L’Hospital, Paris, De Boccard, 2005.
« L’unité du droit vue par un arrêtiste toulousain, Géraud de Maynard (1537-1607) », La règle de l’unité ? Le juge et le droit du roi dans la France moderne (XVe-XVIIIe siècle) sous la direction de P. Arabeyre et d’O. Poncet, Paris, Classiques Garnier, 2019, p. 19-44.
« Cujas et les arrêtistes. L’écho de l’École au Palais », communication au colloque Jacques Cujas 1522-1590. La Fabrique d’un “grand juriste”, Paris, Editions du Collège de France, Collection « Conférences », p. 177-196.
Xavier Prévost est agrégé des facultés de droit, agrégé d'économie et gestion, archiviste paléographe (diplômé de l'École des chartes) et ancien élève de l'ENS Cachan. Membre junior de l'Institut universitaire de France (promotion 2020), il est professeur d'histoire du droit à l'université de Bordeaux et porteur du projet ISTHisFrench (ERC-2024-COG 101170233). Il coordonne avec Luigi-Alberto Sanchi le Réseau Humanisme juridique. Ses recherches concernent le droit et les savoirs juridiques à la Renaissance et interrogent, en particulier, l'émergence de la modernité juridique.
Jacques Cujas (1522-1590), Jurisconsulte humaniste, Genève, Droz (Travaux d’Humanisme et Renaissance), 2015 ; rééd. Genève, Droz (Titre courant), 2025
Jacques Cujas, la fabrique d’un « grand juriste », dir. Alexandra Gottely, Dario Mantovani et Xavier Prévost, Paris, Éditions du Collège de France, 2024
L’Humanisme juridique. Aspects d’un phénomène intellectuel européen, dir. Xavier Prévost et Luigi-Alberto Sanchi, Paris, Classiques Garnier (Esprit des lois, Esprit des lettres), 2022 [https://doi.org/10.48611/isbn.978-2-406-11801-5]

-
 New Perspectives on Neo-Latin Correspondences during the Early Modern Period06 May07 May...
New Perspectives on Neo-Latin Correspondences during the Early Modern Period06 May07 May...Organisé par Farah Mercier (FNRS, UCLouvain / KU Leuven), Aline Smeesters (FNRS, UCLouvain), Hans Cools (KU Leuven), Raf van Rooy (KU Leuven) et Pierre Assenmaker (UNamur)
En savoir plus